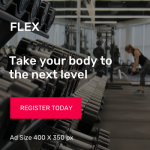Les restes d’une lettre d’amour, quelques photos de familles encore intactes, un pantalon, une ceinture… C’est tout ce qui reste du « Numéro 387 ». Ce numéro c’est celui d’une des milles personnes victimes d’un terrible naufrage survenu le 18 avril 2015 au large des côtes libyennes. Depuis, une poignée d’anthropologues légistes et de travailleurs humanitaires travaillent à identifier ces morts souvent réduits à des numéros. Pendant plus de trois ans, des cimetières de Sicile aux villages de Mauritanie, la réalisatrice Madeleine Leroyer a suivi leur long et patient jeu de pistes. Co-écrit par Cécile Debarge et produit par Little Big Story, Numéro 387 disparu en Méditerranée a été présenté en compétition dans les plus grands festivals. Il sera projeté au FIFO, samedi 12 février, à 19h au Grand Théâtre. Rencontre avec la productrice Valérie Montmartin.
Vous avez décidé de produire un film sur la migration, à une époque où on en parlait beaucoup, et de surcroit par une réalisatrice qui faisait son premier film. Pourquoi avoir fait le pari de vous engager ?
Le point de départ du film est la question anthropologique des morts en Méditerranée. La réalisatrice était vraiment accrochée à cette idée qu’ils disparaissent et n’existent plus, ils ne sont donc plus considérés comme des êtres humains mais des numéros. A ce moment-là, je crois beaucoup en Madeleine et je décide donc de lui payer un billet pour qu’elle aille chercher des histoires un peu partout en Europe. Elle revient fin de l’été 2017 avec des pistes d’histoires. Dans ces histoires, il y a celle d’un légiste à la frontière nord de la Grèce qui récupère des cadavres de personnes tentant de traverser le fleuve. Il avait commencé à travailler sur l’identification de ces cadavres et recensait tout ce qu’ils avaient sur eux. On part sur cette histoire même si ce médecin en particulier n’est finalement pas dans le film mais on est parti sur toutes les histoires de légistes. Avec la journaliste Cécile Debarge, qui deviendra co-autrice du film, Madeleine enquête sur la question. A cette époque, l’État italien avait la volonté de remonter un bateau ayant coulé à 1 000 mètres de fond non loin de la Lybie mais dans les eaux italiennes. L’enjeu était d’avoir les autorisations pour filmer les autopsies des corps et, surtout, qu’on soit les seuls à pouvoir le faire. Après de longues négociations, on a fini par obtenir trois jours pour filmer. Celui qui deviendra 387 est un corps décomposé mais il existe ses photos, ses lettres… Et, surtout, on a ce geste qui ouvre très délicatement le portefeuille, et dans ce geste on a l’idée du respect du mort. Quand Madeleine et Cécile rentrent, on a le film, on a un trailer qui va faire le tour du monte.
Vous avez une démarche en tant que productrice d’accompagnement des réalisateurs ?
Les réalisateurs comme les producteurs sont des filmmaker. C’est exactement le terme utilisé par les Anglosaxons qui ne distinguent pas ces deux professions. Je trouve que ça convient bien à nos métiers. On est des filmmaker, on prend la gestion du film par un autre axe mais on le fait ensemble. Et, en tant que productrice, j’ai la responsabilité du film. J’ai donc intérêt à accompagner si je ne veux pas à la fin me dire que ce n’était pas du tout le film qu’on s’était imaginé. Un film est un objet qui peut être informatif, artistique ou tout ça à la fois. Il va être regardé par des gens et doit aussi respecter ceux qui sont dedans. L’accompagnement sur les premiers films est donc nécessaire. Si on n’accompagne pas les jeunes réalisateurs on ne pourra pas en faire des filmmaker. Et, si on a misé sur eux, notre intérêt est qu’ils fassent le meilleur film possible avec les difficultés qui sont inhérentes à un premier film.
Même si ce film parle de migrations en Europe, vous le présentez au FIFO, en Océanie ?
Numéro 387 est une histoire de mer, on monte sur un bateau, on part pour aller vers un ailleurs et on est stoppé net. On a aussi dans cette histoire une idée de différence de représentation, comme si certains valaient plus que d’autres dans ce qu’ils sont et dans leur dignité. Le film parle à tout le monde, partout sur la planète, puisqu’il rappelle une règle très simple : il n’y a pas d’êtres humains qui soient supérieurs aux autres d’où qu’ils viennent.
Numéro 387, c’est aussi un film d’impact
Numéro 387 avait une première ambition, celle de redonner un nom aux migrants morts dans la Méditerranée. Mais ce documentaire poignant a aussi une autre ambition : celle d’avoir un impact. La productrice et la réalisatrice ont donc élaboré une stratégie et mené une campagne d’impact. L’objectif de #numbersintonames est de faire progresser le travail d’identification des corps et de promouvoir le droit des familles à savoir. Rencontre avec la réalisatrice du film, Madeleine Leroyer.
Comment vous est venu l’idée de l’impact ?
Elle a commencé à émerger avec toutes les actions qu’on menait pour convaincre qu’il ne s’agissait pas d’un énième film sur les migrants mais qu’on faisait valoir l’aspect humain, anthropologique. C’était la question des morts aux frontières, et cette question est un voyage humain. En faisant ce chemin, ce sont mis en place les jalons de la campagne d’impact. C’est à ce moment-là qu’on a vu les choses se renverser : on a fait le tour du monde des Pitchs. En 2017, on s’est retrouvé au EDN où on a pu prendre conscience qu’il fallait déjà d’élaborer une stratégie. Après deux jours d’ateliers, on a candidaté pour le Good pitch Europe. En plus de la préparation en amont, les ateliers, un suivi génial et toute une liste de suggestion, on est reparti avec des sous, des contacts et une énergie incroyable.
Comment s’est déroulé la suite ?
On a lancé la campagne pour aider et porter un plaidoyer pour ces disparus et le droit pour leurs familles à savoir. Un an après le Good pitch Europe, on a fait la première du film et un atelier pour l’impact en invitant des partenaires privilégiés. Démarre alors pour nous le circuit des festivals. En 2020, on lance une campagne participatif qui est freinée avec l’arrivée du covid et du confinement. On avait peur de tout perdre du coup ça été le vrai branle-bas de combat pour activer tous les réseaux mais aussi les gens lambda. Ça a bien marché mais surtout ça a bien renforcé le fait qu’à un moment où les gens étaient préoccupés par autre chose, la crise sanitaire, on arrive tout de même à faire reconnaître la pertinence et la force de ce projet. Ça nous a d’ailleurs servi d’arguments pour la suite.
Quelle est la suite justement ?
On ne sait pas jusqu’où ça peut aller mais mon travail sera terminé quand ce sera pérenne, quand tout ce qu’on a mis en place pourra continuer tout seul. Là, on est très content car on va pouvoir enfin proposer le film de façon large en streaming gratuit sur tout le continent africain. On a aussi élaboré un circuit de cinéma mobile, le premier doit avoir lieu en juin au Sénégal. Il doit servir d’appui à l’action de l’association sur place qui se mobilise sur ce sujet et faire émerger une parole des familles et des proches sur la question. On va rapporter les clips qui vont nourrir la campagne.
Qu’est-ce que vous avez appris avec cette campagne d’impact ?
Qu’il faut commencer le plus en amont possible et qu’il faut associer l’ensemble des acteurs : producteurs, réalisateurs, distributeurs. Il faut aussi valoriser un certain nombre de partenariats sans transaction mais qui apportent une logistique, du soutien, des lieux, des compétences. Mon grand conseil : il faut bien choisir ses partenaires et faire preuve d’humilité. Et idéalement, il faut travailler avec d’autres campagnes d’autres films. Les campagnes d’impact c’est formidable mais très peu financées. Si on a essuyé beaucoup les plâtres, on a fini par obtenir le soutien par exemple d’une fondation (60 000 dollars), on a fait le kickstater (ndlr : campagne participative), on a aussi créé une association Impact Social Club pour faciliter son travail et faciliter son financement. Si on a mis six ans à faire le film, on a mis plus de quatre ans à travailler sur l’impact. Faire de l’impact c’est possible, et à la fois pour un film promu à un grand festival comme un film de France 3 région, ce qu’il faut surtout c’est un investissement de l’équipe du film. Ce qui est gratifiant également avec l’impact est que le film n’est pas dans un tiroir, c’est comme un bébé : ça vit et surtout ça vit sa propre vie.
Article rédigé par Sulianne Favennec